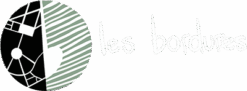Dans le milieu viticole bordelais, tout le monde semble connaître Jean-Baptiste Duquesne, et tout savoir sur son initiative Bordeaux Pirate. Comme pour tout phénomène « disrupteur », le champ médiatique largement ouvert par cet auto-proclamé trublion a entraîné nombre de raccourcis simplistes, de classifications hors-sujet, voire de contresens. Vu de ma place, celle d’un bordelais passionné de vin blessé par le Bordeaux-bashing (bien qu’y participant !) et attendant le Grand Jour du Grand Rebond des vins de Bordeaux, j’en attendais beaucoup. Et n’y comprenais rien. Il me fallait donc me faire une idée plus précise : je rencontrai donc Jean Baptiste Duquesne ce mercredi matin bruineux de fin novembre, chez lui à Château Cazebonne.
Il fallait d’abord faire le point sur son activité de vigneron. Parce que c’est ça la moëlle. C’est ce qui fait la différence entre les blablateurs-commentateurs-marketeurs que je suis et qu’il fut, et ceux qui créent, qui pensent et fabriquent le produit en accord avec la terre et les éléments. La terre, à Cazebonne, c’est 30 ha de parcelles autour du chai, sur le plateau de Peyron, à 3 km au sud-est de Langon. Les éléments, ce sont quatre années calamiteuses sur ses six premières : gel, grêle, sécheresse, mildiou. Ce sol de graves, argiles et limons est certainement gage d’une grande qualité des vins mais l’emplacement n’est pas un cadeau pour le vigneron. En témoigne cette vigne de Merlot qui paraît non-vendangée, tant les grappes intégralement séchées par le mildiou sont nombreuses, restées sur les souches. Pas besoin d’être « pirate » pour le constater : le Merlot, ce n’est pas l’avenir, trop pote avec le mildiou. Il faut changer les fréquentations du raisin : JB a pris dès son arrivée en 2017 le parti de replanter des cépages locaux anciens, ses « cépages oubliés », censés être plus résistants aux maladies locales, et plus aptes à affronter le réchauffement climatique. Saint-Macaire, jurançon noir, bouchalès, mérille, mancin, castets produisent déjà et constituent le début d’une collection qui va s’étoffer de 60 rangs « conservatoires » d’autant de cépages rares. C’est un long travail de plantation puisque les pépiniéristes ne fournissent évidemment pas ces clones. Les porte-greffes sont déjà en place, mais ne se sont pas développés suffisamment pour envisager le greffage cette saison. Il faudra attendre une année de plus. On sent bien que le travail sur le temps long qu’exige la viticulture, l’inertie que cela implique, contrarie Jean-Baptiste.

Car ce que vise ce brillant créatif venu de l’univers du digital, start-upper d’avant la startup nation, gastronome et grand connaisseur de vin (qui m’invite au resto du coin à condition de ne pas y boire de vin) : ce qui fait briller ses yeux, c’est le produit final. Tout, de l’achat du domaine à la viticulture en biodynamie, du travail de chai au choix des assemblages, cuvées, étiquettes, tout est pensé pour le jour où le vin sera présenté au consommateur. Tout est bon, original, se démarque, fait discours. Cela m’a beaucoup impressionné car je n’ai pas l’habitude de côtoyer de tels capitaines de navire, dans le monde très terrien de la viticulture bio. Généralement, bien que le discours soit toujours assez volontariste, rares y sont les choix humains dans la chaîne de production qui ne soient dictés par l’habitude, l’héritage familial ou l’environnement socio-culturel. C’est parfois ce qui surprend chez les vignerons natures, censément engagés, « auteurs » de vin, qui parfois servent un discours de chapelle, attendu. Leurs choix sont ceux de tout un groupe social qui interagit, une intelligence collective qui unifie les pratiques et règne sur la fourmilière.
Mais le pirate n’est pas fourmi. JB Duquesne, alors qu’il n’a vendangé qu’une année à plein rendement (30 hl/ha), embouteille plus de 20 cuvées. Toutes ont un sens. Et pas mal ont leur clip de rap en QR code sur l’étiquette. Le chai est très bien équipé, les vinifications se font soit en cuve béton neuve, soit « intégrales » en barriques et amphores. Les élevages : en cuve, barriques de 500L , amphores et œufs en terre de tailles diverses. Les levures sont indigènes, les vins sont sulfités. En bouteille tout est net, sauf une qui passe dans le verre de JB mais n’ira pas dans le mien, et traduit parfaitement l’intention annoncée. Mention spéciale aux blancs, le « Feldspath de Peyron » et l’incroyable et d’ailleurs épuisé vin de macération ont ma préférence. Ce sont des sauvignons bien mûrs, mais équilibrés, aromatiques mais sans thiols, sans « pipi-de-chat ». Le Grand Vin blanc que JB appelle son « Pessac-Léognan » est bien meilleur que nombre de vins végétaux et surboisés de cette appellation. La texture aérienne des rouges, les goûts surprenants de ces cépages oubliés en font des cuvées atypiques pour le bordelais, mais nettes, sages et agréables pour l’amateurice de vins classiques. Ce qui est incontestablement novateur.

Et c’est autour de ce concept d’innovation que nous allons entamer la conversation sur les Bordeaux Pirate. Car comme tout un chacun j’avais lu la prose de Sud-Ouest et de Junk Page, vu leur site internet et je m’y perdais un peu : que venaient faire des grands négoces de familles bordelaises comme les vignobles Ducourt aux côtés d’artistes-artisans comme mon ami Max Juillot de SKJ Domaines ?
C’est qu’en fait il ne s’agit pas de « labelliser » des pratiques viticoles pour informer les consommateurs et unifier les vigneron·nes concerné·es, mais bien de dégager une attitude, une intention derrière chaque cuvée Pirate. Qui peut être solide, reliée à un projet agricole entier tournant le dos aux vieux fonctionnements bordelais poussiéreux, ou alors tout à fait être opportuniste, passagère, sur une petite partie de la production. C’est permis. Se déclare pirate qui veut. Une seule vraie restriction est de proposer au jury des vins issus de vignes en bio ou en conversion. Et l’autre, plus permissive, est de savoir terminer la phrase « Je suis Pirate, parce que… » : où l’on doit démontrer dans un exercice libre qu’on innove pour casser l’image du Bordeaux désuet bordeaux-bashé. Un tel est pirate parce qu’il plante des cépages oubliés, une autre parce qu’elle élève les vins en amphore, ou fait la fermentation malolactique sur ses blancs, un monocépage, une macération carbonique, un vin orange, met de la musique dans les vignes… Si je m’y perdais, c’était normal, c’est volontaire : on doit pouvoir faire entrer dans les Pirates le maximum de type de vignobles, indépendant, négoce, cave coop, il y aura peut-être même prochainement un Grand Cru classé.
Chaque vigneron autoproclamé Pirate, et réglant son adhésion modique à l’association doit fournir deux cuvées pour être qualifié Bordeaux Pirate (si le vin est en AOC Bordeaux) ou Cuvée Pirate (pour les vins de France, IGP et vins non-éligibles à l’AOC). Le jury note à coef 1 en quoi le vin est novateur et pirate, et à coef 2 sa qualité organoleptique. Ce deuxième critère permettant d’éliminer les cuvées à défaut, car on est quand même à Bordeaux : le « vignoble des œnologues », fut-il Pirate, ne saurait être représenté par des vins phénolés, plein de bretts, de gaz, d’oxydation, de bois*. Cela permet une définition assez précise du créneau du Bordeaux Pirate, tout à fait à l’image des vins de JB Duquesne : des vins qui tranchent avec le passé par leur image, tout en respectant une technicité œnologique dont on peut raisonnablement penser qu’elle est partie intégrante du terroir bordelais. Le consommateur aussi est partie du terroir, lisez Jean-Robert Pitte à ce sujet et votre vie changera. Et le public visé par ces cuvées Pirate, justement, est celui qui a des doutes sur les idéalistes, « les hippies » qui croient faire bouger les choses en faisant des vins naturels ultra-déglingués et qui, il est vrai, phagocytent le concept d’innovation dans pas mal de régions viticoles et à longueur de colonne d’une presse bienveillante.
En gros, sont Pirate des cuvées sages mais aux concepts nouveaux, à destination de ceux et celles qui ne se fatiguent pas avec de la politique et veulent un vin bien net bien droit pour briller sur la table, prompt à convaincre tout le monde de la réussite de ces concepts novateurs. La boucle est bouclée. « Qu’est-ce qui change vraiment alors ? » me demanderez-vous. Dépoussiérer l’image des Bordeaux en présentant le vignoble par son côté innovant et dynamique, jeune, sans en changer les structures. L’idée est brillante et il y a de fortes chances pour que ça marche. Jean-Baptiste, le type au bob sur les photos de la comm de Bordeaux Pirate, y croit dur comme fer : « J’espère que l’initiative marquera le début de la fin du Bordeaux-bashing ». C’est tout ce qu’on lui souhaite ! En tout cas, je peux faire taire les critiques entendues ici et là, accusant l’homme de monter les uns contre les autres, au final de nuire à l’image de la majorité des Bordeaux pour s’arroger, lui et son association d’initiés triés sur le volet, le monopole de la vertu et de l’innovation. C’est un contresens majeur car au contraire JB Duquesne a l’ambition de regrouper tout le monde sous son pavillon pirate, de manière très large, presque universelle, et c’est même à mon sens ce qu’on pourrait lui reprocher : comment maintenir l’image du trublion, de l’alternative libératrice, quand on tend à englober ceux-là même qui incarnent ce qu’on prétend remplacer ? Un défi compliqué que cet homme impressionnant d’intelligence, cet artiste de la persuasion, saura à coup sûr relever. Mais c’est un pari risqué car la structure est associative et il pourrait tout à fait y perdre son rôle de leader. Il devra, même. « Ça ne sera peut-être qu’un passage, mais l’important, c’est le déclic. Et le déclic, il est là, c’est déjà réussi. »
Rafael Bord, Décembre 2023

*Ah si, de bois, c’est bon, c’est admis, c’est un caractère masquant le côté fruité du vin qui n’est pas considéré par l’œnologie bordelaise comme un « caractère masquant le côté fruité du vin » (selon la définition du défaut apprise par coeur par chaque étudiant de l’ISVV).